|
Paris le 17/8/2006

Cher Florent,
Votre dernier roman, Les Fantômes du Brésil, vient de paraître. Ah, les Fantômes, le Brésil, deux mots presque synonymes !… Cela sent de l’histoire. Démarche nouvelle de votre part. Toute chose qui excite la curiosité…
Pouvez-vous nous mettre au parfum ? Juste ce qu’il faut… pour nous mettre sur la braise…
Amicalement,
Blaise APLOGAN, Paris

Cotonou le 20/8/2006
Cher ami,
(...) Eh bien, heureux que ma compagnie littéraire vous soit agréable...
A vos internautes, je voudrais me risquer à quelques explications sur mon dernier roman, Les Fantômes du Brésil, même si l'exercice paraît parfois malaisé.
J'ai écrit ce texte pour revenir un peu à moi, à ma famille, du côté de ma mère da Costa. pendant toute mon enfance, j'ai baigné dans les histoires de zombis, de fêtes carnavalesques dont on dit qu'elles viennent, pour l'essentiel de Salvador de Bahia, le Brésil, l'origine prétendue de mon grand père maternel. A la maison, je voyais les amies de ma mère venir très souvent pour parler de bourignan, le carnaval des agoudas. D'ailleurs, elles avaient pour nom Santos, d'Almeida, de Souza, do Régo, Diogo, etc. Elles en parlaient avec une grande fierté tant et si bien que j'ai fini par penser que moi aussi je venais du Brésil et j'avais un regard plutôt condescendant sur mes camarades de classe...
Alors, une fois adulte, j'ai voulu revisiter ce sujet. Bien sûr, au collège, des pans entiers de cette histoire nous ont été enseignés. Mais c'était loin de l'éclairage que je pouvais moi-même avoir à travers les contacts avec la collectivité agouda, à travers différentes documentations. Ce qui m'importait, c'était de plonger au cœur de cette communauté agouda, de la faire vivre et de la confronter aux réalités et aux habitudes de vie des gens du milieu. Cette communauté que l'on voit à travers la famille do Mato, se présente comme des gens lovés sur eux-mêmes, sur leurs cultures faites de ressentis et des réminiscences issues de Bahia. Seule l'attitude de leur fille Anna-Maria amoureuse d'un natif de Ouidah - car l'histoire se déroule dans cette petite ville historique- tente de briser cet enfermement. D'ailleurs, on lui reproche cette liaison qui, aux yeux des agoudas, est contre nature. Puisqu'ils estiment que les autochtones ont prêté leur complicité aux négriers qui avaient déporté leurs arrières grands parents.
Ici, je n'invente rien. Bien au contraire; quand ces esclaves se sont affranchis et sont revenus dans le Golfe du Bénin au milieu du vingtième siècle, ils avaient créé une espèce de caste, brandissant cet argument à leurs frères du terroir . Ce qui a constitué, pendant longtemps, des sujets de discordes entre les deux collectivités. Aujourd'hui, cet antagonisme a disparu. Mais pour habiller mon histoire et lui donner quelques reliefs anthropologiques, j'ai forcé sur les traits, en empruntant cet argumentaire à l'histoire. Ce que d'ailleurs j'ai pris le soin de préciser en épitaphe au roman.
Si toutes mes publications, jusque là on utilisé Cotonou comme cadre de narration, cette fois-ci, j'ai choisi Ouidah avec son quartier Brésil, avec ses monuments historiques, avec sa plage - point terminal de la route des esclaves - pour camper mon décor. C'est un exercice qui m'a beaucoup enthousiasmé puiqu'il m'a permis de me déplacer dans la ville, d'y prendre des notes d'interroger les gens, de fouiller les archives, bref, de donner un visage différent de Ouidah de notre éternel aîné Olympe Bhêly-Quenum
Que dire d'autre? Il y a tellement de choses à raconter que je préfère m'en arrêter là et recevoir des questions précises sur d'autres aspects de ce roman.
Amicalement
Florent Couao-Zotti, Cotonou

Paris le 21/8/2006
Cher Florent,
Je vous remercie de vos réponses qui apportent de précieux éclaircissements sur les Fantômes du Brésil. (...) L’un des objectifs que nous visons à Babilown c’est partager avec nos compatriotes le plaisir sinon l’heur d'une reconnaissance-découverte des valeurs de chez nous : littéraires, artistiques et plus généralement culturelles.
Comme vous le dites, jusqu’à présent, tous vos écrits ont utilisé Cotonou et la société actuelle comme cadre. Certes, Cotonou est la fille historique de Ouidah, et les maux d’aujourd’hui ne sont pas une génération spontanée ; alors comment expliquez-vous ce shift ? (pour parler franglais) Est-ce seulement un basculement vers un autre théâtre ? Une simple migration de registre : du sociologique à l’historique ? Ou bien, à un moment donné, vous vous êtes senti à l’étroit dans les lieux et les temps ? Une manière de creuser plus profond pour mieux exprimer vos thèmes essentiels ?
Autre question : vous avez choisi, d’entrée, c’est-à-dire dès le titre de l’œuvre, d’annoncer la couleur (critique). Est-ce délibéré ? Pourquoi ?…
Pour ma part, je suis persuadé que votre pioche est tombée au bon endroit. Les Fantômes du Brésil, en ressuscitant des ténèbres d’une mémoire en veilleuse, vont contribuer à rafraîchir les esprits ; gageons qu’ils renouvelleront dans le même élan la vision merveilleuse d’une ville, Ouidah, qui a un besoin fou de rééquilibrer son identité...
Parler de soi et de son oeuvre est, je le sais, un exercice médiatique qui n'est pas toujours facile ; aussi, je vous prie d'accepter mes sincères remerciements pour avoir bien voulu vous y prêter de bonne grâce...
Très amicalement,
Blaise APLOGAN, Paris

Cotonou le 24/8/2006
Cher ami,
Je vous remercie pour votre réaction. Réaction qui s’est nourrie d’autres questions, toutes aussi intéressantes les unes que les autres.
Pourquoi avoir choisi la ville de Ouidah comme espace d’action : simple besoin de changement de décor ? Serait-ce pour mieux accuser les lignes historiques et sociologiques de mon histoire ? Ou cela répond-il à une préoccupation particulière ?
D’abord, il me parait difficile, en abordant un thème aussi délicat que celui des descendants d’anciens esclaves revenus du Brésil, de choisir une localité autre que Ouidah. Certes, on aurait pensé à Porto-Novo, Grand Popo et, accessoirement Agoué. Mais Ouidah, c’était la ville des grandes migrations portugaise, française, hollandaise et américaine. Ouidah, c’était le pied à terre des rois d’Abomey qui, du 17ème siècle jusqu’à la fin du dix-neuvième, l’avaient utilisé comme zone franche pour tous les types de commerces, surtout pour le « bois d’ébène ». C’est surtout la ville où le plus grand des négriers de la côte s’était installé, don Francisco de Souza dit Chacha qui, en tant qu’inséminateur infatigable, a coloré la population de plus d’une centaine de ses rejetons. Ouidah, c’est surtout le quartier Brésil – même si, apparemment bon nombre de maisons du style portugais ont été détruites – avec ses limites géographiques sud qui s’ouvrent sur la route de l’esclave.
Donc, il m’a paru, pour mettre en relief la césure qui existe entre les collectivités agouda et les autochtones, le malaise qui empreigne les relations – ici, j’ai pris le risque de l’exagération pour la nécessité de l’intrigue – d’installer mon roman dans cette ville.
D’un autre côté, Ouidah pour moi, était un dépaysement littéraire. D’autant que la ville, pendant longtemps, m’avait paru très lointaine de mes préoccupations. Le fait de m’éloigner de Cotonou, de plonger mes yeux dans cette cité, de secouer certains artifices, certains préjugés que l’on impute à ses habitants, m’a permis de me détacher de mon cadre de prédilection littéraire pour traquer d’autres vérités, d’autres réalités et mesurer, avec le recul nécessaire, tout le bonheur qu’un écrivain a à s’investir dans un lieu aussi chargé d’histoire. A des moments donnés, j’ai eu l’impression, en parcourant certains sites, que chaque morceau de terre me parlait, que chaque feuille d’arbre me tutoyait. Surtout quand on se rend à la porte du non-retour. J’ai eu le sentiment d’entendre les râles d’esclaves, le claquement des fouets se mêler au soupir du vent et à l’écume des vagues qui viennent se briser sur la plage.
Enfin, le titre : Les Fantômes du Brésil.
J’ai voulu risquer une provocation : les fantômes, ici, représentent cette culture aussi hybride qu’insaisissable dont se réclament ces agoudas, culture qui ne constitue qu’un pan, qu’une réminiscence des expressions identitaires des Noirs du Brésil, précisément de Bahia. Parce que je me suis rendu compte que bon nombre de ces gens-là font référence très souvent au Brésil. Comme s’ils en étaient originaires. Comme s’ils y avaient encore leurs parents. C’est vrai que, dans les fêtes des agoudas, il y a souvent quelques traits de manifestations qui rappellent vaguement le Brésil : les chansons, les vêtements, la cuisine. Mais à voir de près, on se rend compte que c’est de l’arnaque, ce que j’appellerai de l’ « arnaque inconsciente ».
Car, les textes des chansons sont inaudibles, c’est du charabia « enchanté » : ni portugais, ni brésilien, ni même africain. Les vêtements relèvent du style du début du siècle et font penser à la bourgeoisie de l’époque. Et la cuisine, à part trois repas…bref, c’est…fantomatique.
Voilà les quelques explications que je peux vous apporter…
Amicalement,
Florent Couao-Zotti, Cotonou
Lire aussi

© Copyright, Blaise APLOGAN, 2006

|
|
|
J’ai bien reçu ta dernière lettre, et je te remercie pour ta confiance et ton amitié ; vivante complicité placée sous le signe Ô combien enrichissant du partage des idées. Dans cette lettre, entre autres choses, tu me demandes si j’ai eu connaissance de ce que tu appelles avec pertinence “ les derniers assauts biologiques du divin Roger Gbégnonvi” et le cas échéant, tu voudrais savoir ce que j’en pense. Oui, cher ami, j’ai lu la dernière chronique du saint-homme. Dans ce texte logiquement tiré par le cheveu, l’ex Ministre de Yayi et chroniqueur devant l’Eternel affirme que l’UN n’est que l’US, l’Union fait le Sud. En fait et pour abonder dans le sens ironique que tu donnes au mot Biologie en l’occurrence, le sous entendu implicite est que le vrai UN devrait avoir pour candidat unique, Bio Tchané (BT), pour lequel notre Intellectuel bicéphale a déjà déclaré sa flamme. Ce qui donne comme, tu le poses avec clarté, l’équation : UN = US+ BT !



 EXCLUSIVITE !!!
EXCLUSIVITE !!!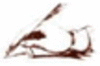
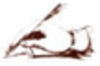
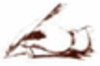


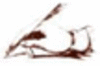
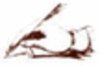
![writting[1]](https://blaisap.typepad.fr/mon_weblog/WindowsLiveWriter/writting%5B1%5D_thumb.gif)

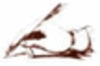


 En tout cas, pour la
En tout cas, pour la 




Les commentaires récents